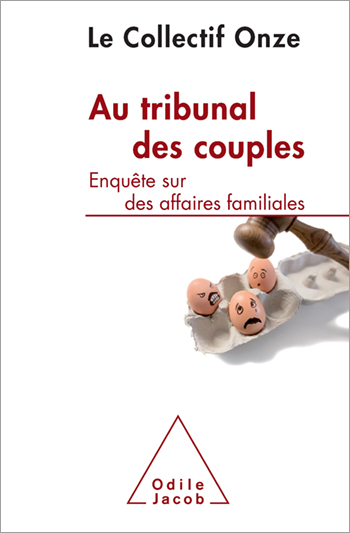
« Au tribunal des couples : enquête sur des affaires familiales », le Collectif Onze, Odile Jacob, 312 pages
Trois cent trente-cinq audiences et cinq cents dossiers épluchés, seize juges de cinq tribunaux suivis dans l’exercice de leur métier… Depuis au moins vingt ans, aucune enquête de cette envergure ne s’était intéressée à la justice des affaires familiales en France. « Au tribunal des couples », paru hier aux Editions Odile Jacob, est le résultat de ces trois ans de recherches inédites menées par un collectif de onze sociologues au plus près des soupirs, des récriminations et des déchirements des « ex » dont la route s’est séparée. Alors que 400 000 procédures ont lieu chaque année en France pour statuer sur les modalités de la rupture conjugale et que le divorce est censé être « pacifié », on y découvre une réalité… parfois aux antipodes des préjugés.
La majorité des procédures ne sont pas des divorces.
« Le divorce n’est plus l’activité majoritaire des juges aux affaires familiales », explique Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l’université de Paris-Dauphine et membre du collectif de chercheurs. La séparation des concubins, que l’on pourrait penser plus facile puisque il n’y a pas de lien légal à défaire, encombre de plus en plus les tribunaux dès lors qu’il y a des enfants (plus d’un sur deux naît hors mariage). Et surtout, les « déjà divorcés » sont très nombreux à repasser… une seconde fois, voire une troisième, devant le juge. « C’est la conséquence de la réforme du divorce de 2004 qui a facilité le consentement mutuel, éclaire la sociologue. Aujourd’hui, on divorce vite mais pas forcément bien. Et il faut souvent repréciser le partage de l’éducation des enfants. ».
La résidence des enfants pose peu de problème.
A force de voir les pères escalader des grues, des sénateurs s’en émouvoir au point de décréter la résidence alternée prioritaire, on en viendrait à penser que le film « Kramer contre Kramer » se rejoue chaque jour dans les tribunaux de France. « Ce n’est absolument pas le cas » insiste la chercheuse. « Il faut presque se surprendre, au contraire, d’une évidence : les mères demandent systématiquement que les enfants habitent chez elles, et la plupart du temps, les pères acquiescent ou ne disent rien. » Il y a davantage de litiges sur les week-ends et les vacances que sur la résidence en elle-même (et encore, ils portent très rarement sur une demande de résidence principale par le père). En vérité dans l’immense majorité des cas, assure-t-elle, cette question est « à peine discutée ».
Le litige n° 1 : la pension alimentaire, à l’euro près.
Le vrai sujet qui fâche est aussi le plus méprisé : la pension alimentaire. Et si l’inconscient collectif fantasme sur des affaires de gros sous ou des tentatives pour « plumer » l’autre à bon compte, la réalité est autrement misérable : hommes et femmes s’écharpent souvent pour 10 ou 20 € tant la pension est modeste et la fourchette resserrée. La moitié des sommes fixées par le juge est située entre 90 et 150 € par mois et par enfant, en fonction des revenus du parent non gardien et non des besoins du parent gardien. D’ailleurs dans un tiers des cas, c’est bien simple, il n’y en a même pas. « Un père au chômage ou au RSA est très souvent jugé impécunieux, a constaté la sociologue. Le juge préfère alors fixer la pension à 0, pour permettre à la Caisse d’allocations familiales de prendre le relais et être sûr que la mère touchera bien 90 € par mois. » Les seules affaires de gros sous, on les trouve dans les demandes de prestations compensatoires, dans les divorces de milieux aisés où la femme s’est sacrifiée… Et encore ! De 93 000 € en moyenne du temps où cette compensation était versée sous forme de rente à vie, elle est tombée à 22 000 € maintenant qu’elle est soldée en une fois.
Des divorces… en dix-huit minutes !
Qui a dit qu’il était interminable de divorcer ? Aujourd’hui, il s’écoule en moyenne quatre mois entre le dépôt de la requête et le passage devant le juge. « Quand le consentement est mutuel, l’audience dure trois minutes. Et même quand il y a des contentieux, c’est dix-huit minutes en moyenne », notent les chercheurs. Ce qui est beaucoup plus long, c’est l’attente entre requête et audience pour les parents non mariés qui se séparent. Et pour les « déjà divorcés » qui reviennent régler ce qui ne l’a pas été dans la précipitation la première fois. Ceux-là (les plus nombreux, rappelons-le) attendent sept mois en moyenne pour voir leur cas très souvent expédié. « On s’est aperçu que les audiences étaient plus courtes quand il n’y avait pas d’avocat », avoue Céline Bessière. « Car même si les avocats sont censés cadrer et faciliter les choses, ils prennent le temps de plaider et ont l’oreille des juges. Or, dans ces requêtes hors divorce, l’avocat n’est pas obligatoire et beaucoup s’en passent, surtout les personnes modestes : 64 % des ouvriers se présentent au tribunal sans conseil… » Le timing parle de lui-même : 13 minutes sans avocat, 17 avec un avocat et 27 minutes avec deux !
De l’abattage qui reproduit les inégalités.
Moins on a d’argent, moins on a d’avocat, plus vite est réglé notre cas, moins élevée est la pension… « La justice des affaires familiales perpétue l’ordre social et les inégalités » constate finalement le collectif « en fragilisant les justiciables qui sont à la fois des femmes, et modestes ». Pour autant, trois ans d’enquête ne leur feront pas blâmer les juges, qui prennent les mêmes décisions qu’ils soient hommes ou femmes (contrairement à une autre idée reçue). « Chacun d’eux traite 800 dossiers par an, ils travaillent le soir, le week-end, ont des piles et des piles de dossiers qui s’entassent chaque semaine, concluent les sociologues. C’est une institution essentielle contre la loi du plus fort, mais elle manque cruellement de moyens. »
